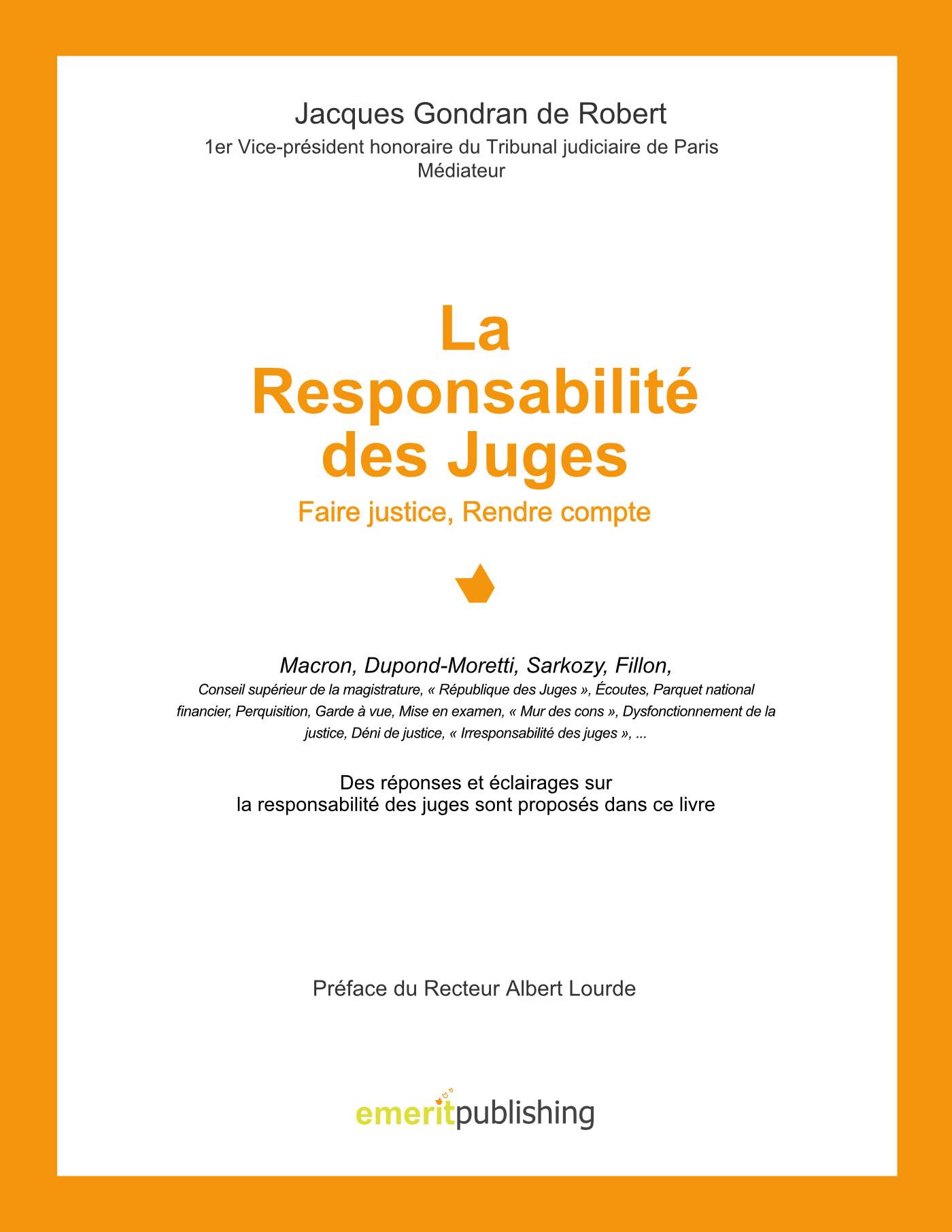Dans son excellent ouvrage La responsabilité des juges Jacques Gondran de Robert*, haut magistrat émérite, répond à cette question à la fois délicate et essentielle : les juges seraient-ils irresponsables ? Entretien avec l’auteur qui évoque des affaires sensibles : Viry-Chatillon et Gisèle Halimi.

Il ne se passe pas un jour sans que la justice ne soit maltraitée. Elle serait mal rendue et les juges resteraient irresponsables. A ce jeu, la presse n’est pas en reste comme d’ailleurs les gouvernants. Que dites-vous aux citoyens qui s’interrogent ?
Jacques Gondran de Robert– Contrairement à la croyance commune, les juges ne sont pas au-dessus de la loi, ils la servent. D’où l’intérêt d’examiner les critiques principales qui sont dirigées contre eux et de façon plus globale contre la justice pour rechercher leur part de responsabilité.
Allons plus loin.
Tous les délinquants sont-ils sanctionnés ?
Non, mais…
En matière de délinquance, l’on doit distinguer 3 situations bien différentes.
On sait que la police avec les moyens dont elle dispose fait le maximum pour élucider plus d’affaires. Or, pour un 1/3 des infractions commises, les auteurs n’ont pu être identifiés. On ne connaît rien sur eux.
On ne peut pas condamner des inconnus. Les juges ne peuvent être responsables de cette situation.
Pour un gros autre 1/3, il n’y a pas de poursuites engagées par la justice parce que, dès l’enregistrement des plaintes de victimes, il apparaît évident, toujours compte-tenu des moyens dont dispose la police aujourd’hui, que les poursuites ne pourront pas au final aboutir à une condamnation, en raison d’absence de preuves suffisantes, d’existence de faits qui ne constituent pas une infraction pénale…
En définitive, seules 3 affaires pénales sur 10 peuvent être traitées utilement par la justice. Mais pour celles-ci, mêmes réduites au 1/3, l’on entend que la justice est trop laxiste. La question mérite d’être examinée.
Les juges sont-ils laxistes ?
Non, mais…
Les prisons françaises sont pleines, en situation de surpopulation carcérale.
A supposer que les juges sanctionnent plus souvent et plus gravement, où pourra-t-on emprisonner ces nouveaux condamnés ?
Dans l’affaire de Viry-Chatillon (crimes de 2016), certains des accusés (8 sur 13) ont finalement été acquittés alors que 5 autres subissaient des peines allant de 6 à 18 ans de réclusion criminelle. Il leur était reproché d’avoir attaqué et brulé des policiers. Pour certains, le laxisme des juges était avéré.
Mais, ce ne sont pas des juges professionnels qui ont pris la décision le 18 avril 2021, mais bien une majorité de jurés siégeant en cour d’assises. Or les jurés sont des citoyens tirés au sort et non des juges de carrière.
Pour autant, l’on peut de façon légitime se poser la question d’une réforme permettant de mieux sanctionner ceux qui tuent ou agressent des agents publics d’autorité.
La prison est-elle criminogène ?
Oui, mais …
Trop souvent, les condamnés à la sortie de la prison se retrouvent moins socialisés qu’à l’entrée. Aussi, ne serait-ce que pour ce seul motif, il est important de lutter contre l’engorgement des prisons.
Dans mon ouvrage « La responsabilité des juges », j’aborde longuement cette question : A-t-on tout fait pour éviter cela ? La réponse est « non » !
Des résultats plus satisfaisants pourraient sans doute être obtenus si l’on accordait à la justice la possibilité d’être plus proactive, aux fins de réinsertion, dès les 1ers jours de l’incarcération. Avoir recours à ce que j’appelle « l’écrou d’investigations », à défaut d’avoir trouvé mieux.
De nos jours, on ne profite pas assez de l’impact, pour un primo-condamné à la prison de ce que certains professionnels (psychologues, psychiatres, et autres intervenants en justice) dénomment le « principe de réalité » qui peut – j’ose le dire, avec prudence, à mon tour et avec eux – être éveillé par une incarcération de très courte durée. L’emprisonnement suit immédiatement la condamnation pénale, mais pour un temps très bref.
C’est exactement le contraire de ce qui a été décidé par une loi du 23 mars 2019, qui a interdit les peines d’emprisonnement inférieures à 1 mois, abandonnant ici l’individualisation des peines. Je partage l’avis de Pierre Botton (qui a « l’expérience de la justice ») pour qui il faut : « que la première minute de condamnation soit la première minute de réinsertion ».
Il s’agirait de se saisir de ce moment particulier où la personne incarcérée (qui dans notre hypothèse découvre la prison pour la 1ère fois, la « vraie ») pour poser un diagnostic et tenir une audience spécifique, dans les tous 1ers jours de la détention, pour permettre d’envisager une sortie de prison dans les jours suivants. Une révolution à envisager !
Par ailleurs, en raison de la surpopulation carcérale, beaucoup de délinquants ne sont pas envoyés en prison après leur première arrestation par la police.
Aussi, ils peuvent commettre de nombreuses autres infractions avant d’être emprisonnés. La prison, ainsi, ne peut être responsable des actes qui ont précédé et justifié leur 1er internement.
Le crime précède la prison. Si l’on veut être efficace, il faut agir dans et hors des prisons. La prison est criminogène mais la société l’est tout autant.
En sortant n’y a-t-il pas trop de libérés qui récidivent ?
Oui, mais…
Aujourd’hui, aucune peine de prison n’est vraiment perpétuelle. Ne faudrait-il pas libérer les prisonniers le plus tard possible.
Mais, pour protéger la population, ne pourrait-on pas garder en prison tous les condamnés, même ceux qui n’auraient pas commis d’infractions gravissimes. Personne ne le pense, fort heureusement.
Pour autant, nombreux sont les délinquants qui, alors même qu’ils ont exécuté leur peine et retrouvé leur liberté, restent dangereux pour les autres.
Aussi, pour la protection de tous, il est urgent de renforcer les systèmes de sureté « post-peine » mis en place ces dernières années, bien insuffisants pour garantir la paix en société en particulier en raison aujourd’hui de la violence d’islamistes fanatiques, tout en veillant toujours, bien sûr, à une individualisation des mesures.
Vos remarques valent constat général sur la justice, mais l’actualité ne pousse-t-elle pas à aller plus loin ?
JGdR -Le Président de la République met-il en cause l’indépendance de la justice (en saisissant le Conseil supérieur de la magistrature) ?
Non, mais…
Depuis la Révolution de 1789, la France connait un régime dit de « séparation des pouvoirs », législatif (Assemblée nationale + Sénat), exécutif (Gouvernement + Président de la République) et judiciaire (l’ensemble des tribunaux et autres institutions judiciaires dont le Conseil supérieur de la magistrature.
Afin d’assurer un minimum de coordination entre ses organes, la Constitution de 1958 a confié au Président de la République la mission de garantir l’indépendance de la justice, tout en se faisant assister pour ce faire, par le Conseil supérieur de la magistrature.
Aussi, n’est-il pas surprenant que le Président, en février dernier, ait sollicité l’avis de ce Conseil qui – et ceci n’est pas neutre – fait office, par ailleurs, parmi bien d’autres fonctions de Conseil de discipline des magistrats.
Tout au plus, peut-on souligner qu’en République il est légitime de faire examiner par le Conseil, comme l’a fait le Président « la possibilité de mieux appréhender l’insuffisance professionnelle du magistrat dans son office juridictionnel ».
Cette initiative peut cependant se révéler délicate pour le Président qui a pour mission de respecter et de faire respecter, non pas tant le « principe d’indépendance » des juges qu’il invoque dans sa demande d’avis que leur indépendance effective.
On attend avec intérêt l’avis du Conseil supérieur de la magistrature sur ce point, comme sur celui des plaintes de justiciables.
Faut-il rendre plus efficace le dispositif des plaintes de justiciables. ?
Oui
Depuis 2010, tout justiciable qui estime, qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant, le comportement adopté par un magistrat (juge ou procureur) dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature.
Or, 97% des requêtes de justiciables (qui sont de l’ordre de 2000/an) sont déclarées irrecevables par la « Commission de filtrage » qui siège au sein dudit Conseil, sans même que ce dernier puisse se saisir du fond de la plainte.
Ce n’est pas surprenant. En effet, la saisine du Conseil n’est pas une voie de recours contre un jugement (ce n’est ni un appel, ni un pourvoi en cassation, ni…). Elle ne peut en aucun cas aboutir à une modification d’une décision de justice.
Ainsi, il existe un malentendu. Les plaignants croient en s’adressant au Conseil, qu’ils pourront obtenir une réformation de la décision de justice qu’ils critiquent. Alors que le nouveau mécanisme de 2010 ne porte pas sur la décision d’un juge mais sur son comportement.
En aucun cas l’on ne peut dire que le mécanisme existe pour protéger les juges ou qu’il fonctionnerait mal parce que les juges privilégieraient « l’entre-soi ».
En revanche, il faut rendre plus lisibles la nature et la portée de ces plaintes.
Le Conseil, dans ses rapports annuels d’activité, a déjà acté cette méprise et a même déjà réagi et formulé des suggestions.
Il ne serait pas surprenant que le Conseil propose au Président que la Commission de filtrage se voit accorder – de façon officielle – le droit de motiver une décision en cas de rejet ou même lorsque la plainte vise seulement un comportement inadapté sur un plan déontologique, mais qui ne constituerait qu’un manquement non délibéré ou véniel.
Cela permettrait pour la Commission de filtrage de ne pas être prisonnière d’un choix simpliste : décider de l’irrecevabilité de la plainte (rejet trop sec) ou saisir la formation disciplinaire du Conseil (processus trop lourd).
Pour éviter ce tout ou rien, la Commission de filtrage a déjà pris l’initiative de motiver le cas échéant, ses décisions de rejet.
Mais le Conseil supérieur de la magistrature pourrait saisir l’occasion pour aller plus loin. Alors que la Commission de filtrage fonctionne avec 2 compositions pour le « Siège » et 1 pour le « Parquet », pourquoi ne pas proposer une composition mixte unique – comme l’amorce d’une composition mixte unique du Conseil lui-même en matière de discipline – retirant ainsi au garde des Sceaux le pouvoir de sanctionner un parquetier. Cela permettrait une égalité de traitement disciplinaire pour tous les magistrats.
Comprenez-vous, dans l’affaire « Gisèle Halimi », le malaise de l’opinion publique ?
Oui, mais …
Dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, un individu entre dans l’appartement de sa future victime. Il devait être interpellé par la police vers 5 heures 35, en train de réciter des versets du Coran. Il est avéré qu’il avait défenestré sa victime, de religion juive, qui polytraumatisée devait décéder.
Poursuivi pour homicide volontaire, il n’a pas été déclaré responsable de ses actes par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris, le 19 décembre 2019, lors de son passage à l’acte, pour avoir agi atteint d’un trouble neuropsychique ayant aboli son discernement.
La Cour de cassation, par arrêt du 14 avril 2021, a validé cette décision. C’est cet arrêt, qui en l’état reste difficilement compréhensible dans l’opinion.
Des débats judiciaires, il résulte que le tueur avait peut-être consommé du cannabis, comme d’autres boivent de l’alcool pour calmer leur anxiété. Il n’aurait eu aucune conscience de ce que cette consommation illégale pouvait provoquer un délire, une « bouffée délirante aiguë ». En effet, il n’aurait jamais vécu une telle bouffée psychotique, alors pourtant qu’il était un consommateur habituel de cannabis. (NB : ceux qui veulent légaliser la consommation de cannabis devraient penser aussi aux conséquences dangereuses de celle-ci pour le consommateur et même les autres, les effets de son abus étant très comparables, à ceux de l’alcool, consommation dont la distribution est pourtant contrôlée légalement).
Son maintien prolongé dans un établissement médical spécialisé confirmera ou non l’existence d’un trouble « inaugural », dans un processus qui pourrait être de nature schizophrénique, pouvant alors « abolir » effectivement son discernement (art 122-1 du code pénal).
Pour autant, comme l’a fait valoir la famille, l’intéressé a tenu des propos de nature antisémite avant et après avoir jeté la victime par la fenêtre.
Dès lors, n’a-t-il pas conservé une part de conscience, sélective, lors du passage à l’acte.
Mais alors, son discernement n’aurait pas été « aboli » mais seulement « altéré », ce qui aurait pu autoriser une condamnation pénale, qui n’a pas eu lieu.
C’est sur ce point primordial que la famille de la victime et de nombreux citoyens auraient souhaité voir s’établir des débats judiciaires plus complets, qui auraient permis en particulier d’interroger publiquement les experts médicaux et même des sociologues, sur ce qui reste encore mystérieux, voire incohérent.
Le besoin de justice est flagrant, tant l’office du juge est bien en priorité d’apaiser la vie en société.
Cependant, le Conseil supérieur de la magistrature rappelle à bon escient dans son dernier communiqué que, pour « préserver les équilibres démocratiques », le juge se doit d’appliquer la loi et s’interdire de la créer ou de la modifier. En matière pénale il doit même l’interpréter de manière stricte.
La question rebondira sans doute sous d’autres formes. Judiciaire d’abord, alors que des questions se posent déjà, par exemple sur la réactivité ou non des services de police à intervenir. Légale aussi, alors qu’a été annoncée une réforme qui pourrait aboutir dans quelques semaines à un nouveau texte législatif.
*La Responsabilité des juges, par Jacques Gondran de Robert, 1er vice-président honoraire du Tribunal judiciaire de Paris. Editions Emerit Publishing. 31,50 € (ebook 18€) – lien non sponsorisé
Durant 40 ans, Jacques Gondran de Robert a dirigé des juridictions pénales, civiles et commerciales dans l’Hexagone comme en Outre-mer, de juge des enfants au Juge des urgences, en passant par la direction de Cours d’assises. A la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris qu’il a présidée 10 années, il a eu à trancher la question de la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la Justice, thème central de l’ouvrage.