Le prix Nobel de littérature 2025 est décerné à l’auteur hongrois László Krasznahorkai « pour son œuvre fascinante et visionnaire qui, au milieu d’une terreur apocalyptique, réaffirme le pouvoir de l’art ».
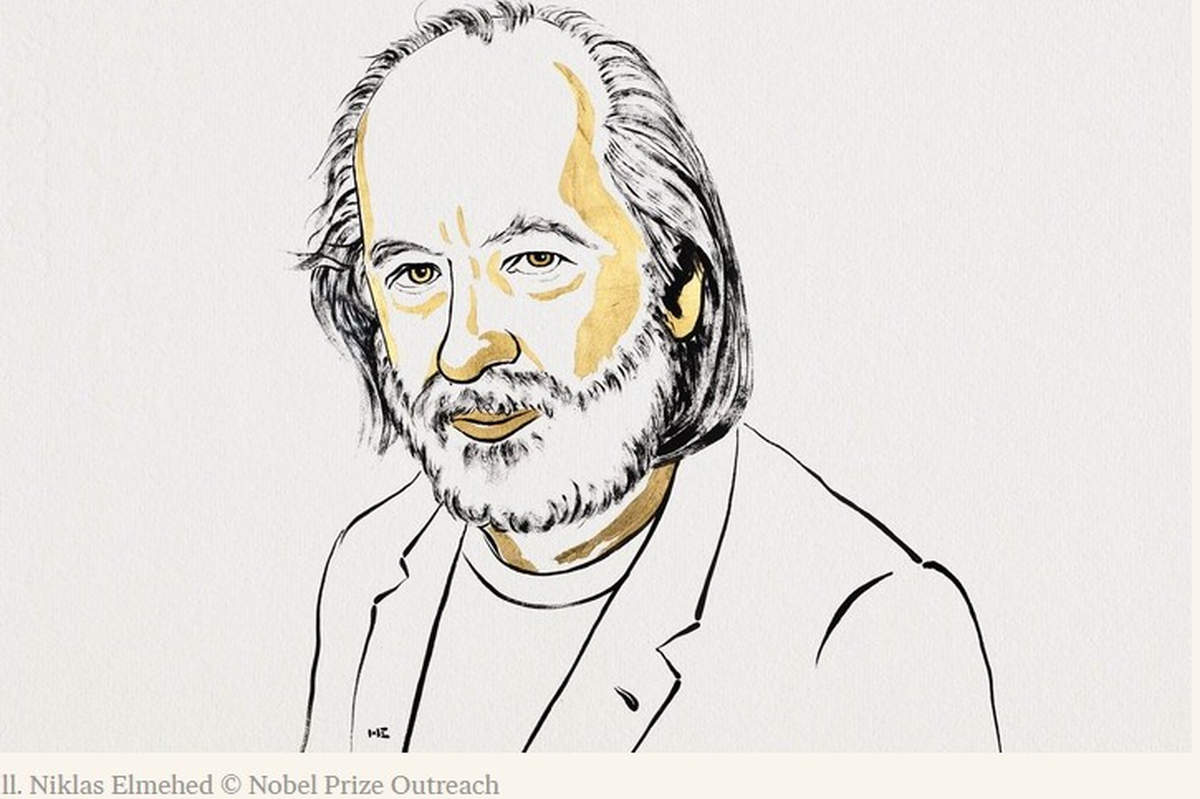
László Krasznahorkai est un grand écrivain épique dans la tradition d’Europe centrale qui s’étend de Kafka à Thomas Bernhard, et se caractérise par l’absurdisme et l’excès grotesque. Mais il a plus d’une corde à son arc, et il se tourne également vers l’Orient en adoptant un ton plus contemplatif et finement calibré.
Roman adapté au cinéma
L’auteur László Krasznahorkai est né en 1954 dans la petite ville de Gyula, au sud-est de la Hongrie, près de la frontière roumaine. Une région rurale isolée similaire sert de décor au premier roman de Krasznahorkai, Sátántangó, publié en 1985 (Satantango, 2012), qui a fait sensation dans le monde littéraire hongrois et a permis à l’auteur de se faire connaître. Le roman dépeint, en termes puissamment suggestifs, un groupe de résidents démunis dans une ferme collective abandonnée de la campagne hongroise juste avant la chute du communisme. Le silence et l’anticipation règnent, jusqu’à ce que le charismatique Irimiás et son acolyte Petrina, que tout le monde croyait morts, apparaissent soudainement sur les lieux. Pour les résidents qui les attendaient, ils semblent être les messagers soit de l’espoir, soit du jugement dernier. L’élément satanique évoqué dans le titre du livre est présent dans leur morale d’esclaves et dans les faux-semblants du filou Irimiás qui, aussi efficaces que trompeurs, laissent presque tous les habitants dans l’embarras. Tous les personnages du roman attendent qu’un miracle se produise, un espoir qui est d’emblée anéanti par la citation de Kafka en exergue du livre : « Dans ce cas, je vais manquer la chose en l’attendant. » Le roman a été adapté en un film très original en 1994, en collaboration avec le réalisateur Béla Tarr.
« Maître de l’Apocalypse »
La critique américaine Susan Sontag a rapidement couronné Krasznahorkai « maître de l’apocalypse » de la littérature contemporaine, un jugement auquel elle est parvenue après avoir lu le deuxième livre de l’auteur, Az ellenállás melankóliája (1989 ; La Mélancolie de la résistance, 1998). Ici, dans un récit d’horreur fiévreux qui se déroule dans une petite ville hongroise nichée dans une vallée des Carpates, le drame est encore plus intense. Dès la première page, nous nous retrouvons, avec la peu charmante Mme Pflaum, plongés dans un état d’urgence vertigineux. Les signes avant-coureurs abondent. L’arrivée dans la ville d’un cirque fantomatique, dont l’attraction principale est la carcasse d’une baleine géante, est déterminante dans la succession dramatique des événements. Ce spectacle mystérieux et menaçant déclenche des forces extrêmes, provoquant la propagation de la violence et du vandalisme. Pendant ce temps, l’incapacité de l’armée à empêcher l’anarchie ouvre la voie à un coup d’État dictatorial. À travers des scènes oniriques et des personnages grotesques, László Krasznahorkai dépeint avec brio la lutte brutale entre l’ordre et le désordre.
Personne ne peut échapper aux effets de la terreur.
Dans le roman Háború és háború (1999 ; War & War, 2006), Krasznahorkai porte son attention au-delà des frontières de sa Hongrie natale en permettant à l’humble archiviste Korin de décider, comme dernier acte de sa vie, de voyager de la banlieue de Budapest à New York afin de pouvoir, l’espace d’un instant, prendre place au centre du monde. De retour chez lui, dans les archives, il a découvert une épopée ancienne d’une beauté exceptionnelle sur le retour des guerriers, qu’il espère faire connaître au monde entier. La prose de Krasznahorkai a évolué vers une syntaxe fluide, avec de longues phrases sinueuses dépourvues de points, qui est devenue sa marque de fabrique.
War & War, dans son style picaresque, anticipe le grand roman Báró Wenckheim hazatér (2016 ; Le Retour du baron Wenckheim, 2019), bien que cette fois-ci, l’accent soit mis sur le retour au pays natal, Krasznahorkai jouant généreusement avec la tradition littéraire. Ici, l’idiot de Dostoïevski se réincarne dans le baron désespérément épris et accro au jeu. Ruiné, il rentre chez lui en Hongrie après avoir passé de nombreuses années en exil en Argentine. Il espère retrouver son amour d’enfance, qu’il n’arrive pas à oublier. Malheureusement, au cours de son voyage, il confie sa vie à Dante, un scélérat présenté comme une version crasseuse de Sancho Panza. Le point culminant du roman, qui est à bien des égards son apogée comique, est l’accueil joyeux réservé au baron par la communauté locale, que le protagoniste mélancolique cherche à tout prix à éviter.
Traduction en français
À partir de la fin des années 1990, ses œuvres ont été traduites en français : l’une des plus importantes, La Mélancolie de la résistance (2006, Gallimard), mais aussi chez Cambourakis, dès 1999, Guerre et Guerre, Au nord par une montagne, au sud par un lac, à l’ouest par les chemins, à l’est par un cours d’eau (2003), Seiobo est descendue sur terre (2008), Le Dernier Loup (2009), Le baron Wenckheim est de retour (2016) et Petits travaux pour un palais (2018).
