Didier Demazière, Sciences Po – USPC
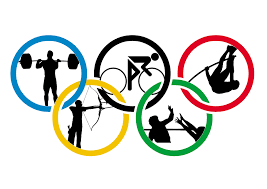
Les Jeux Olympiques de Rio s’annoncent sur fond d’une affaire de dopage dans le sport russe et de soupçons visant plusieurs pays africains ou caribéens. Les rumeurs et scandales de dopage sont inséparables des compétitions sportives. Lors des Jeux de 1904 déjà, le coureur Thomas Hicks n’aurait probablement pas remporté le marathon sans l’injection pendant la course de doses de strychnine, un produit prohibé depuis. Le premier cas de dopage avéré date des Jeux de 1968 à Mexico, quand furent inaugurés les tests antidopage.
Depuis lors, la lutte contre le dopage s’est considérablement développée, mais le phénomène ne semble pas reculer. Comment expliquer la persistance du dopage en dépit des actions menées pour l’éradiquer ? Qu’est-ce qui conduit au dopage ? La lutte anti-dopage s’attaque-t-elle réellement aux racines du problème ?
Contrôler toujours plus les sportifs
La lutte antidopage consiste principalement à repérer et à sanctionner les sportifs qui prennent des substances illicites en vue d’améliorer leurs performances, et à punir leurs entourages (encadrement sportif, technique, médical) s’ils sont complices. Cette politique de contrôle est complétée par des actions préventives, visant à informer les sportifs, notamment les jeunes, sur les dangers sanitaires du dopage et à les sensibiliser aux règles éthiques sportives. Mais cette prophylaxie reste diffuse et peu visible, tandis que le volet répressif, qui cible les sportifs les plus performants, a été continûment renforcé.
La coordination de la lutte antidopage a franchi un palier à la fin des années 1990 quand le Comité International Olympique (CIO) a initié la création d’une Agence mondiale antidopage (AMA) indépendante. En 2004, un Code mondial antidopage a été instauré, qui harmonise les politiques et réglementations des organisations sportives du monde entier.
Ce code énonce des standards dans différents domaines : l’organisation des contrôles, les protocoles des laboratoires d’analyse, la liste des substances et méthodes interdites, la réglementation des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, etc. Depuis 2005, les athlètes ont l’obligation saisir dans une base de données (le système ADAMS) les informations sur leur localisation, afin de se rendre accessibles en permanence à d’éventuels contrôleurs. La surveillance des sportifs est donc constamment resserrée.

Alistair Ross/Flickr, CC BY
En outre, la performance des tests est sans cesse améliorée – ce qui permet de détecter de nouvelles substances, ou des prises administrées selon des protocoles sophistiqués qui les rendaient indétectables jusque là. De plus, les échantillons urinaires et sanguins sont désormais conservés, afin d’effectuer des tests rétrospectifs en utilisant des méthodes inexistantes au moment des prélèvements.
La course au dopage
Actuellement plus de 200.000 échantillons sont analysés chaque année sous l’égide de l’AMA, parmi lesquels 1% environ est positif. L’athlétisme arrive en tête dans le palmarès des violations des règles antidopage (17% des cas en 2014), devant le culturisme, le cyclisme et la musculation. Ce classement ne reflète pas le poids des pratiques dopantes, car chaque discipline compte un nombre différent de pratiquants d’élite (cibles prioritaires des contrôles) et la lutte antidopage y a une ampleur très variable.
Depuis l’introduction de contrôles, des cas positifs ont été décelés à chaque olympiade. Seule exception, les Jeux de 1980 à Moscou, toutefois connus comme les « Jeux des pharmaciens » en référence au dopage d’État découvert après la chute des régimes socialistes est-européens. La surveillance des athlètes est désormais resserrée : aux Jeux de 2012 à Londres plus de la moitié d’entre eux ont été contrôlés, et ils ont été avertis que des contrôleurs pouvaient à tout moment faire irruption dans leur chambre.

DPMS/Flickr, CC BY-SA
Parallèlement, les pratiques dopantes se réinventent constamment : le dopage sanguin est jalonné par les différentes générations d’EPO jusqu’aux transfusions sanguines ; les stéroïdes à l’origine de l’affaire Balco – obligeant Marion Jones à rendre ses cinq médailles conquises aux Jeux de 2000 à Sydney – n’ont rien à voir avec ceux du premier grand scandale de dopage, celui de Ben Johnson, vainqueur du 100 mètres des Jeux de 1988 à Séoul.
Derrière la course à la performance se déroule une course au dopage, qui recourt à des innovations constantes (en termes de produits et de protocoles) afin d’échapper à des contrôles eux aussi de plus en plus performants. La clé est l’innovation, ce qui implique des investissements financiers, et ce qui réserve l’accès au dopage sécurisé et (quasi) indétectable aux athlètes d’élite, à ceux qui peuvent en assumer les coûts économiques.
Une triche individuelle ?
La lutte antidopage ne parvient pas à éliminer le fléau. Mais elle puise sa légitimité dans le ciblage des athlètes, objets de surveillance, de contrôles, de sanctions. Deux figures du sportif dopé émergent des affaires.
La première est celle de la transgression involontaire des règles, par erreur, inattention ou méconnaissance. Les athlètes contrôlés positifs mobilisent parfois cette figure, arguant qu’ils ont ingéré des aliments pollués, qu’ils ignoraient que le produit était interdit, qu’ils ont été abusés par leur entourage, qu’ils ont omis de modifier leur déclaration de localisation à la suite d’événements inopinés, etc. L’argument est celui de la bonne foi. Et il est parfois jugé recevable par la justice sportive.

Ian Gampon / Flickr, CC BY-ND
La seconde figure, contre laquelle est construite la lutte antidopage, est celle de la déviance volontaire, de la tricherie délibérée, de la fraude intentionnelle. Le sportif dopé doit être sanctionné, car il enfreint le principe d’égalité des concurrents devant l’épreuve sportive. En transgressant cette règle fondamentale, il menace l’édifice sportif dans son ensemble. Car la compétition sportive repose sur une morale méritocratique : chacun doit concourir en mobilisant ses seules qualités personnelles et en les développant par l’entraînement. Les performances sont alors le résultat des talents et du travail.
Selon cette morale, c’est le plus méritant qui gagne, alors que le dopage procure un avantage concurrentiel immoral et illégitime. L’égalité démocratique est le socle de la compétition et du système sportif. Et la lutte antidopage entretient cette idéalisation, car en concentrant l’attention sur une rupture d’égalité désignée comme illégitime elle occulte, et légitime, d’autres inégalités, économiques par exemple. C’est pourquoi les athlètes dopés doivent être sanctionnés. C’est pourquoi la lutte contre le dopage prend principalement la forme d’une lutte contre les dopés, désignés comme des tricheurs.
Une contrainte systémique
Mais les racines du dopage sont plus profondes, plus structurelles et moins individuelles, plus systémiques et moins isolées. Il n’est pas une addition de déviances délibérées pratiquées par des tricheurs ; il est une conséquence de la recherche de performance sportive et du travail qu’elle implique. Or les conditions du travail sportif sont largement ignorées par la lutte antidopage, alors qu’elles pèsent lourdement sur la vie des sportifs de haut niveau.
Le dopage n’est pas une simple déviance individuelle délibérée, parce que l’expérience du travail sportif est envahie par l’exigence de performance et de résultats. Pour s’y plier il faut résister à de fortes charges d’entraînement, repousser les seuils de la douleur, affronter les blessures, traverser des périodes « sans », dominer les moments de doute, maintenir une hygiène de vie rigoureuse, répondre aux injonctions des entraîneurs, atteindre les objectifs, etc.
Il faut surmonter ces épreuves constantes pour se maintenir dans le monde sportif où la performance est envahissante, où elle est la mesure de la valeur, et où elle est la condition de la survie. Et ce culte de la performance est d’autant plus exigeant que les conditions d’emplois sont fragiles et les engagements contractuels précaires. Dès lors, le dopage n’est pas seulement une pratique qui vise de manière directe la performance. Il soutient, plus largement, l’engagement dans le sport de haut niveau, en favorisant la récupération physique, la remédiation psychique, l’intégration sociale, la résilience. Il est une réponse à un ensemble de contraintes, physiques, psychologiques, contractuels.
A cet égard le sport n’est pas bien différent de nombre d’autres milieux professionnels où les pressions sont fortes et où la prise de substances psychoactives (stupéfiants, alcool, médicaments, les produits varient) permet de tenir ou d’être performant : la liste est longue, depuis les traders jusqu’aux ouvriers, en passant par les milieux artistiques ou les étudiants de filières hyper-sélectives, etc. La sociologie du travail enseigne que de fortes contraintes professionnelles favorisent le recours à des produits de soutien, qui dans le milieu sportif sont étiquetés comme dopage.
En faire le constat, ce n’est pas excuser ou justifier le dopage, d’autant que celui-ci expose les athlètes à de sérieux risques pour leur santé. Mais seule une meilleure compréhension des ressorts du recours au dopage peut permettre d’améliorer une action répressive largement inefficace. Cela exige de rompre avec une vision individualisante et moralisatrice qui érige l’athlète dopé en tricheur cynique, pour prendre en compte les propriétés du travail sportif afin de mettre en débat ce que celui-ci fait aux sportifs de haut niveau. A moins que la méritocratie sportive idéalisée ne soit un obstacle, culturel et institutionnel, empêchant de considérer le dopage autrement.
![]()
Didier Demazière, Sociologue, directeur de recherche au CNRS (CSO), Sciences Po – USPC
La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.
