
Eric Martel, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Selon une rumeur qui circule sur Internet, le coronavirus SARS-CoV-2, à l’origine de l’épidémie de COVID-19, aurait une origine humaine. Il résulterait d’expérimentations sur des germes ou de manipulations génétiques ayant abouti à un virus « chimère ». Ces thèses conspirationnistes s’appuient sur le fait que l’unique laboratoire de recherche biologique classé P4 en Asie est situé à Wuhan et qu’il bénéficie d’un niveau de sécurité maximale.
D’autres rumeurs répandent l’idée que le germe aurait été transmis accidentellement par un chercheur contaminé ou par des animaux ayant servi à des expériences qui se seraient échappés. S’il semble évident que l’institut de virologie de Wuhan n’a pas de vocation militaire et que le SARS-CoV-2 n’est pas une arme biologique ayant « fuité », la frontière entre recherche biologique à usage civil ou militaire n’est pas aussi claire et définitive qu’il y paraît. Des indicateurs fiables permettent de déterminer si un pays s’est lancé ou non dans un programme de production d’armement biologique ; or, jusqu’à présent, la Chine ne semble pas concernée.
Le crime peut parfois être récompensé
Bien plus que les programmes nucléaires, les programmes d’armements biologiques sont marqués par le plus grand secret depuis la Seconde Guerre mondiale. Les premiers sont expérimentés et mis au point par les Japonais de l’unité 731. Dès 1937, les équipes du colonel Ishii, surnommé « le Mengele japonais », utilisent des prisonniers de guerre comme cobayes. Ils leur infligent de grandes souffrances qui débouchent presque toujours sur la mort.
Ces pratiques, qui impliquaient bien entendu le secret absolu, établirent les bases technologiques de tous les programmes d’armement biologique actuels. Lors de leurs expérimentations, les Japonais s’aperçurent que les germes sont difficiles à utiliser : ils sont à la fois fragiles et incontrôlables. Leurs divers essais, que ce soit par des avions épandeurs, des bombardements aériens avec des puces infestées ou des bombes chargées de bacilles se révélèrent d’abord décevants. Par la suite, ils furent en mesure d’affiner leurs techniques et d’obtenir des résultats. Plutôt que de faire subir aux Japonais les foudres de la justice pour leurs crimes de guerre, les Américains et les Soviétiques préférèrent réutiliser leurs compétences, dans le secret le plus absolu, afin de faire passer leurs propres programmes biologiques au stade industriel.
Le secret, toujours le secret
Ce secret est une constante de la guerre biologique. Ainsi en 1942, une épidémie de tularémie, une maladie incapacitante, éclate d’abord dans les rangs de l’armée allemande, puis dans toute la région du Caucase. Pour Kanatjan Alibekov – également connu sous le nom de Ken Alibek, qui fut dans les années 1980 le directeur adjoint de Biopreparat (le principal organisme soviétique de production d’armes biologiques) –, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un épisode de guerre biologique qui a mal tourné. Malheureusement, aucun document ne peut en attester.
Dès 1946, les autorités américaines s’essaient à un effort de transparence. Pour cela, elles décident de lever le voile sur leurs recherches effectuées pendant la guerre. Le moment paraît favorable : chercher des moyens peu conventionnels pour vaincre des ennemis immoraux comme les nazis et les Japonais semble alors justifiable. Mais la réaction de l’opinion publique fut hostile, la peur immémoriale des grandes épidémies refaisant immédiatement surface.

Wikipedia
Dès 1950 et suite à la publication du rapport Stevenson, les recherches reprennent dans le plus grand secret. En 1952, lors de la guerre de Corée, des épisodes infectieux suspects surviennent parmi les Nord-Coréens. Une commission d’enquête internationale du Conseil exécutif du Conseil mondial de la Paix, organisation indépendante soutenue par les Soviétiques, relève des indices laissant imaginer de possibles expérimentations de guerre biologique menées par l’armée américaine. À ce jour, aucun document n’a permis de prouver cette supposée implication.
Ce secret s’est confirmé lors des recherches menées par les Américains dans les années 1960 où ceux-ci disséminèrent dans plusieurs villes des États-Unis des germes dits inoffensifs. Ces expérimentations provoquèrent néanmoins un certain nombre d’hospitalisations pas toujours bénignes. Ces faits ne furent dévoilés que bien plus tard, ce qui n’est pas sans lien avec l’explosion de thèses complotistes dans ce domaine.
Comment les États-Unis renoncèrent à la guerre biologique
Les années 1960 sont une période particulière pour les États-Unis. Les multiples révélations liées à la guerre du Vietnam et aux différents programmes militaires ébranlent la confiance de l’opinion publique. La découverte de plusieurs accidents survenus dans les laboratoires militaires de Fort Detrick, le principal centre de production de germes militarisés, lève un voile sur le programme de guerre biologique. Parallèlement, le grand public apprend que des tests d’épandage de germes ont eu lieu dans le Pacifique. Le 25 novembre 1969, Richard Nixon décide qu’à l’âge de la dissuasion nucléaire, il est temps de renoncer officiellement à concevoir et à produire des armes biologiques offensives.
En 1972, plus d’une centaine de pays, dont les grandes puissances, signent une convention sur l’interdiction de développement, de production et de stockage des armes biologiques et toxines et de leur destruction. Mais ce traité comporte deux failles essentielles. Tout d’abord, il ne prévoit pas de mécanisme de vérification. D’autre part, il n’établit pas de différence nette entre les recherches dites offensives et défensives. En d’autres termes, une nation peut continuer à faire des recherches sur des virus ou des bactéries qui pourraient éventuellement être utilisés comme des armes de guerre si elle est en mesure de justifier qu’elle cherche à se prémunir d’une attaque biologique ennemie ou de l’apparition d’une épidémie naturelle. En revanche, ce traité proscrit de manière claire la production massive de germes à usage militaire. Aujourd’hui, la Russie, les États-Unis et la Chine, entre autres, s’appuient sur cette zone grise afin de mener des recherches militaires très discrètes sur les germes.
Le vaste programme soviétique d’armes bactériologiques
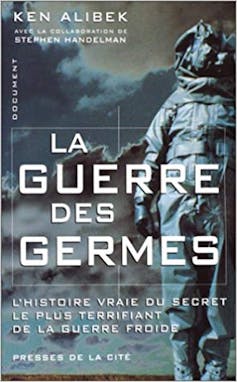
Presses de la Cité
À partir de la fin des années 1970 et jusqu’en 1991, l’URSS va développer les armements biologiques à un niveau jamais atteint auparavant. Sous l’égide de la 15e direction militaire et de Biopreparat, un organisme prétendument dédié à la production de vaccins et médicaments, entre 30 et 60 000 personnes développent et produisent d’importantes quantités d’agents infectieux. Pour Ken Alibek (l’ancien directeur adjoint de BioPreparat, déjà cité), les Soviétiques sont alors en mesure de produire suffisamment de germes pour éradiquer l’espèce humaine. L’URSS étant en infraction avec la convention de 1972 sur les armes biologiques, ce programme est totalement secret. De par son étendue, il permet de situer une frontière nette entre des nations effectuant des recherches pas toujours irréprochables et des pays produisant de manière massive des agents infectieux. Le secret sur ce programme est tel qu’en 1979, lorsque survient un accident qui provoque la mort d’une centaine de personnes, les autorités soviétiques réussissent à faire croire à l’opinion qu’il s’agit d’une épidémie naturelle liée à la consommation de viande avariée. La vérité ne sera connue qu’en 1992 grâce à la chute de l’URSS. De toute évidence, un programme d’une telle ampleur ne pouvait se dérouler sans quelques accidents qui virent plusieurs cas de contamination accidentelle ainsi que des fuites d’animaux utilisés pour les expérimentations.
Les chercheurs soviétiques ont également été les premiers à créer des virus chimères par manipulation génétique. Ils réussirent ainsi à créer un virus apte à déclencher une maladie auto-immune dévastatrice dans laquelle le système immunitaire de l’organisme infecté détruit ses propres organes. Si Ken Alibek fit défection en 1992, ses révélations sur l’ampleur du programme soviétique ne furent dévoilées au grand public qu’en 1998.
Une menace plus subtile qu’il n’y paraît
Aujourd’hui, les manipulations génétiques sur les germes sont très accessibles, surtout grâce aux techniques de fabrication in vitro permettant la synthèse de longs fragments d’ADN à partir de données informatiques.
Différencier les recherches civiles des recherches militaires est relativement difficile. Les manipulations génétiques sur les virus ou les bactéries permettent de mieux comprendre leur fonctionnement. L’administration Bush Junior a ainsi défendu la conception de nouveaux virus offensifs afin de permettre la conception de mesures défensives efficaces. En ce qui concerne la Chine, on sait qu’elle a eu dans les années 1980 une importante activité de production de germes militarisés qu’elle a par la suite abandonnée, d’autant plus qu’elle a signé en 1984 la convention sur les armes biologiques. Il est cependant fort probable que, comme les États-Unis et la Russie, la Chine effectue des recherches sur des germes à vocation militaire dans la plus grande discrétion, une constante dans ce domaine.
Le complotisme a de beaux jours devant lui
Comme le montre l’histoire des armements biologiques, les accidents peuvent survenir à tout moment, les germes étant invisibles. Ainsi Ken Alibek cite sa propre expérience où, jeune directeur de laboratoire, il s’infecta. Ayant marché accidentellement sur un bouillon de culture, il passa par un sas de décontamination ; cela ne fut pas suffisant. Contaminé à la tularémie, le médecin qu’il était sut immédiatement reconnaître le mal qui l’affectait et se traiter avant que la maladie ne fasse des ravages. De la même façon, les témoignages révélant la fuite d’animaux contaminés après des expériences sont nombreux. Évidemment, les niveaux de sécurité actuels sont bien plus élevés, mais les germes ont une capacité surprenante à se répandre. Les thèses conspirationnistes ne sont pas près de s’évanouir dans un domaine où règne l’opacité la plus absolue. Néanmoins, l’inquiétude du grand public à l’égard de ces recherches, qu’elle s’exprime de manière rationnelle ou non, ne peut qu’inciter les chercheurs à renforcer des mesures de sécurité plus que nécessaires dans un domaine hautement sensible.![]()
Eric Martel, Docteur en Sciences de Gestion/Chercheur associé au LIRSA, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
![]()
