
Manuel Faisco/Flicke, CC BY-NC-ND
Alizée Delpierre, Sciences Po – USPC
Les mouvements sociaux de ces derniers mois sont une occasion, ou plutôt, un prétexte, pour évoquer des réalités d’emplois et de nombreuses situations d’exploitation que beaucoup de Français ignorent. Parmi eux, le quotidien des employés domestiques, largement invisibles des discours politiques et des politiques économiques.
Il y a presque un an, je publiais dans The Conversation un article portant sur les situations d’esclavage auxquelles la domesticité peut, dans certains cas, conduire en France.
Car dans un pays marqué depuis plus de trois décennies par la recrudescence des services domestiques à domicile et des politiques publiques qui les encouragent nombreux sont les travailleurs·ses domestiques qui œuvrent quotidiennement chez les autres (peut-être chez vous ?) pour faire le ménage, le repassage, la cuisine, garder les enfants, l’une de ces tâches ou toutes à la fois, et bien d’autres encore.
Plus d’un million de personnes s’y consacrent chaque année, et, même s’il faut être attentif aux façons dont sont produites les données du secteur des services à la personne et aux métiers disparates qu’il agrège, ce chiffre est loin d’être anodin et interpelle sur la place centrale qu’occupent ces employés·ées dans la société française, et qu’elles/ils devraient occuper dans les débats et les luttes sociales actuels.
Sans traiter de la grande variété des situations, on propose de s’intéresser au quotidien d’une femme travaillant comme employée domestique en France, un secteur où les femmes représentent 9 salariées sur 10, et dont beaucoup sont particulièrement touchées par la pauvreté, la précarité et le multi-emploi. C’est ainsi que j’ai rencontré Sonia, femme française et marocaine âgée de 42 ans, lors de mes recherches doctorales.
Cumuler les emplois pour un salaire médiocre
L’intensité des journées de travail interpelle. Sonia travaille quotidiennement en Île-de-France de 6h à 19h pour faire des ménages chez des particuliers. Elle est employée directement par quatre familles et travaille pour chacune d’elles entre 2h et 3h par semaine.
Elle fait donc, au maximum, 12h de ménage par semaine, mais ses journées s’étendent bien au-delà, car ses employeurs vivent loin les uns des autres (entre 45 min et 1h30 sépare leurs maisons), et à plus d’1h15 de chez elle.
Sonia, qui n’utilise pas sa voiture car cela lui coûte trop cher, prend les transports en commun plusieurs heures par jour. Elle doit à la fois planifier son temps de transports entre chaque maison, et prévoir les retards fréquents des trains qu’elle prend.
« Je pars à 4h50 de chez moi, le temps de marcher 30 minutes jusqu’à la gare, et je prends le premier train même si je commence un peu plus tard, car on ne sait jamais. »
De nombreuses études statistiques produites sur le secteur des services à la personne dressent un portrait-type de l’emploi domestique en France, relativement stable depuis le début des années 2000 : un emploi majoritairement à temps partiel, faiblement rémunéré, qui pousse les employées de maison à multiplier les employeurs pour travailler plus d’heures.

Jeanne Menjoulet/Flickr, CC BY-SA
D’après les dernières données produites par la Dares les employées embauchées directement par les particuliers-employeurs (65 % des employées) ont en moyenne près de 3 employeurs, et ce nombre passe à 4,5 lorsqu’elles sont employées à la fois directement par un employeur et via un organisme.
Le nombre total d’heures qu’elles cumulent dans les services à la personne, payées en moyenne entre 8,4 et 9,4 euros nets, équivaut à la moitié d’un temps plein. Loin d’elles de toucher un smic mensuel, quand bien même elles travailleraient en complément dans d’autres secteurs (ce que font plus d’un quart des salariées).
Les emplois ne sont pas cumulables à l’infini, au vu de l’organisation matérielle que cela nécessite (temps de transports, compatibilité des emplois du temps) et de l’investissement physique – et psychologique. Sans oublier qu’en tant que femmes, au travail rémunéré s’ajoute le travail domestique gratuit qu’elles effectuent pour leurs propres familles.
La tour de verre
Parfois, Sonia arrive en avance, et attend en bas des maisons. Elle en profite pour planifier sur son téléphone tout ce qu’elle doit faire dans la journée : aller chercher son fils de 7 ans à l’école entre deux ménages à 16h, passer chez sa mère, qui vit à 1h de son dernier employeur, à la fin de la journée pour récupérer son autre fils de 2 ans, faire les courses, préparer la valise de son troisième fils de 17 ans qui part chez son père pour une semaine à Tanger.
Et il y aussi la « tour en verre » comme elle dit. Quatre soirs par semaine, de 22h à 1h du matin elle récure les toilettes, vide les poubelles, nettoie les moquettes, essuie les taches de café sur les bureaux, lave les sols d’une grande entreprise francilienne. En plus du reste. Ces soirs-là, elle rentre à 3h du matin chez elle avec des bus de nuit. Puis elle repart à peine 2h plus tard.
« Je n’ai pas le choix, dit-elle, je dois travailler au maximum pour nourrir mes trois enfants, et pour vivre, tout simplement. Alors, tant pis si je ne dors pas ».
Sonia élève seule ses enfants. Née en France dans une famille de 7 enfants élevés par leur mère seule, elle s’estime chanceuse par rapport à cette dernière, qui multipliait elle aussi les ménages et la cuisine à domicile, et allait parfois au travail avec un ou deux de ces enfants.
« Ma mère me garde les miens, c’est une chance car je n’ai pas les moyens de payer quelqu’un bien sûr. »
Son aîné s’occupe aussi très régulièrement des deux petits, comme Sonia l’a fait elle-même plus jeune. À 16 ans, comme beaucoup d’adolescentes, elle faisait du baby-sitting pour gagner de l’argent, mais contrairement à d’autres, elle a arrêté ses études.
Il y a quelques années, Sonia a envisagé de suivre une formation d’auxiliaire de vie sociale, mais elle a rapidement abandonné l’idée, faute de temps et d’argent.
Elle et ses fils vivent dans un logement social de 25 m2, et Sonia craint chaque mois de ne pas pouvoir payer son loyer.
« Arrivée le 20, je stresse. Alors j’appelle mes employeurs pour voir s’ils ne peuvent pas me faire travailler encore plus d’heures, le dimanche ou le samedi. Je leur dis que je peux tout faire. De temps en temps, ils acceptent, mais c’est rare. Alors le week-end, je fais des colliers, et je les vends avec mon fils les samedi et dimanche matin au marché, sur le stand d’un copain. »
Entre 500 et 650 euros par mois
Au total, pour un mois de travail additionnant bien plus de 35h, Sonia touche entre 500 et 650 euros bruts, la moitié de ces heures n’étant pas déclarées. Elle perçoit plusieurs aides sociales, et en a honte.
« C’est déjà pas très glorieux d’être femme de ménage, alors en plus, quand tu gagnes ça alors que tu te tues au travail et que tu es obligée de demander qu’on t’aide, tu te sens incapable ».
Elle craint pour le destin de ses enfants, et de son fils de 17 ans, qui « décroche au lycée et travaille déjà beaucoup pour gagner de l’argent, car il voit bien qu’on galère ». Il envisage de partir vivre au Maroc, ce à quoi s’oppose Sonia : « Il va faire quoi, là-bas, sans diplôme ? Tomber dans l’alcool, comme son père ! » s’indigne-t-elle.
Le cas de Sonia illustre, au-delà d’une vulnérabilité certaine sur le marché du travail, un ensemble de conditions sociales et économiques réunies qui caractérisent de nombreuses femmes employées de maison. Âgées d’en moyenne 46 ans, elles sont faiblement diplômées (près de 43 % n’ont pas de diplôme) et proviennent de milieux sociaux défavorisés.
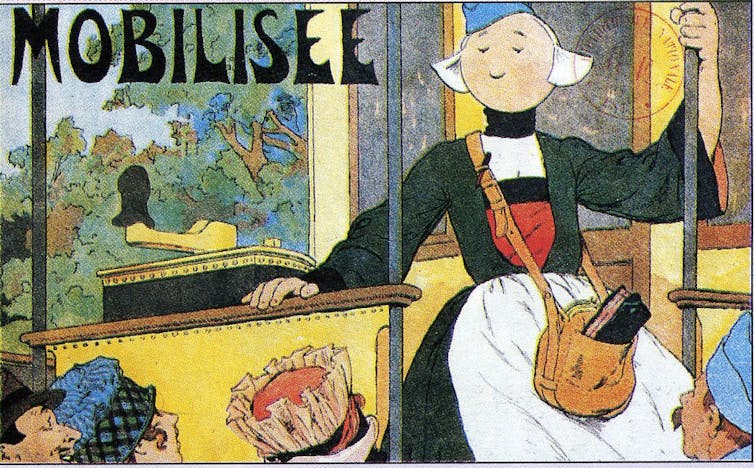
iesmasaxh/Flickr, CC BY-SA
Invisibilisation et silence
Les femmes issues de l’immigration et de nationalités étrangères sont sur-représentées par rapport aux autres secteurs professionnels. Beaucoup ont des enfants, les élèvent seules, ou sont dans une situation familiale instable, des caractéristiques sociologiques et sociales de ces femmes bien connues des chercheurs·ses.
Confinées à l’espace domestique, isolées et non organisées collectivement, le silence règne sur les conditions de travail des employées de maison qui, souvent, n’osent pas ou ne savent pas toujours comment s’exprimer.
Sonia n’est pas syndiquée, ne lutte pas à proprement dit pour ses droits, mais la parole qu’elle confie à la sociologue, à ses proches et à ses amis, est un acte de résistance.
« C’était mon destin, je ne pouvais pas espérer mieux, mais je pense que ce n’est quand même pas normal qu’on soit beaucoup de femmes dans mon cas ».
De nombreuses femmes employées de maison rencontrées sur le terrain de la domesticité confient qu’elles aimeraient voir le silence sur leurs conditions se briser.
« Il faudrait que moi aussi, je porte un gilet jaune ! » s’exclamait Sonia il y a quelques semaines au téléphone.
Est-ce que le mouvement des « gilets jaunes » sensibilisera l’opinion et les pouvoirs publics au quotidien de ces femmes, et catalysera l’avancée des réflexions sur la domesticité en France ?
La proximité de leurs conditions avec celles d’autres travailleurs·ses porteurs·ses de revendications similaires devrait certainement inciter à les inclure aux débats.
On peut aussi questionner l’absence des discours gouvernementaux à leur sujet, au vu de l’implication de l’Etat dans la politique du secteur des services à la personne.

Jeanne Menjoulet, CC BY-SA
De timides mais non moins importantes victoires
Mais des voix ont commencé à s’élever quelques mois avant les événements de l’hiver : le 8 mars dernier, François Ruffin parlait des femmes de ménage à l’Assemblée, une intervention fort commentée sur laquelle la philosophe Geneviève Fraisse revient dans un article. Le 16 juin, une manifestation pour la ratification de la Convention 189 de l’OIT sur les droits des travailleurs·ses domestiques a eu lieu sur le parvis du Trocadéro.
Si ce sont encore peu de choses au vu des enjeux actuels de la domesticité, elles sont favorables à l’enclenchement d’une dynamique collective : c’est en tout cas ce destin, qui s’est déjà fait entendre dans plusieurs pays, qu’on aimerait voir se réaliser plutôt que celui des milliers de femmes comme Sonia.![]()
Alizée Delpierre, Doctorante au CSO, Sciences Po – USPC
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
![]()
